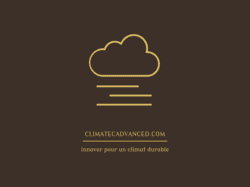Le CNRS progresse vers une transition vers le bas carbone
|
EN BREF
|
Le CNRS se dirige activement vers une transition bas carbone en déployant un plan ambitieux depuis fin 2022. À travers des initiatives concrètes et des projets variés, l’organisme cherche à réduire son impact environnemental. Parmi les actions entreprises, on trouve la sensibilisation et la formation de ses agents aux enjeux environnementaux, la mise en place de pratiques écoresponsables dans les achats, ainsi qu’une politique en faveur des mobilités douces, notamment par la promotion du vélo. De plus, des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique de ses bâtiments sont en cours, contribuant ainsi à la diminution de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le CNRS est déterminé à réduire son empreinte écologique et à mener à bien sa transition vers un modèle économique bas carbone. L’institution, qui a récemment présenté un ambitieux plan, s’attache à mettre en œuvre de nombreuses initiatives touchant divers secteurs, allant de la formation de ses agents à l’intégration de critères environnementaux dans ses processus d’achat. Ainsi, après un an de mise en œuvre de ce plan, les premiers résultats sont visibles et prometteurs. Cet article présente les différentes actions entreprises par le CNRS pour atteindre ses objectifs environnementaux.
Les premiers pas vers un modèle écoresponsable
La mise en œuvre d’un plan de transition bas carbone au CNRS a largement été influencée par la nécessité de répondre aux enjeux climatiques actuels. En effet, le rapport de 2022 sur les émissions de gaz à effet de serre a constitué un jalon important pour définir des actions concrètes. D’après Blandine De Geyer, responsable nationale du développement durable du CNRS, l’engagement de l’établissement requiert un temps de sensibilisation et d’accompagnement pour mobiliser l’ensemble des équipes. Cela passe par des actions ciblées dans les différentes régions et instituts du CNRS, qui commencent à porter leurs fruits.
Sensibilisation et formation des agents
Un levier majeur pour amorcer cette transition repose sur la sensibilisation et la formation des agents. Patrice Guyomar, référent développement durable de la délégation Occitanie Est, a mis en place un cycle de formation autour de la Fresque du climat, une méthode ludique permettant d’explorer les enjeux climatiques. À travers ces formations, le CNRS s’assure que ses agents comprennent les défis environnementaux et sont capables d’adopter des comportements responsables. Entre février 2023 et janvier 2024, neuf personnes ont été formées, enrichissant ainsi la communauté du CNRS en fresqueurs.
Les défis auxquels fait face Patrice et son équipe mettent en lumière la complexité d’introduire de nouvelles missions au sein d’une institution. Beaucoup d’agents craignent d’être submergés par ces nouvelles responsabilités. Cependant, les formateurs insistent sur le fait que chacun doit évoluer à son rythme, et que la participation à des initiatives comme les fresques est avant tout une opportunité d’agir concrètement pour le climat.
Les initiatives d’achats écoresponsables
Au-delà de la formation, les achats représentent un domaine crucial dans la réduction de l’impact carbone. Selon le bilan carbone réalisé par le CNRS en 2019, 74 % de l’impact global provenait des achats. De ce fait, la direction dédiée aux achats et à l’innovation a mis en place des mesures incitant à réduire les achats tout en améliorant leur qualité environnementale. À partir de mai 2023, le CNRS a introduit une nouvelle directive sur les achats écoresponsables, exigeant l’intégration de critères environnementaux dans le processus d’achat.
Avec la constitution d’un groupe de travail composé d’acheteurs régionaux, le CNRS se fixe pour objectif d’aider ses agents à améliorer les futures commandes. Ici, l’accent est mis sur des exigences claires en matière de recyclabilité, d’emballage et de provenance. Ce cadre représente une avancée significative vers des pratiques commerciales plus respectueuses de l’environnement.
Des projets concrets pour limiter l’impact environnemental
La restauration collective comme modèle d’expérimentation
Le secteur de la restauration collective se transforme aussi pour répondre aux enjeux des critères sociaux et environnementaux. D’après Virginie Mahdi, déléguée régionale adjointe, ce secteur se profile comme un véritable terrain d’expérimentation en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). À partir de janvier 2025, un nouveau marché sera renouvelé, intégrant des critères stricts qui pèsent jusqu’à 20 % de l’évaluation des fournisseurs.
Les changements visent à réduire la diversité des offres alimentaires pour optimiser la qualité des produits proposés et ainsi diminuer le gaspillage alimentaire. Exit les bouteilles en plastique individuelles, et bonjour aux produits issus de l’agriculture biologique. Un engagement fort a également été pris pour la redistribution des invendus, en les proposant à des associations locales.
L’énergétique : un virage vers l’efficacité
Les consommations énergétiques des bâtiments sont un autre pivot de la stratégie bas carbone. Environ 15 % des émissions du CNRS proviennent de la consommation d’énergie dans ses bâtiments. Cette situation a motivé des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique. Un exemple marquant est l’isolation renforcée, qui a permis de réduire la consommation énergétique de plusieurs laboratoires et centres de recherche. De plus, le supercalculateur Jean-Zay joue un rôle exemplaire en recyclant sa chaleur fatale pour alimenter son bâtiment et fournir de la chaleur à des milliers de logements.
Promouvoir des mobilités durables
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les déplacements domicile-travail, le CNRS a mis en place une politique en faveur des mobilités douces. En mai prochain, l’établissement participera pour la première fois au challenge « Mai à vélo », visant à inciter ses agents à utiliser le vélo comme moyen de transport. En parallèle, des infrastructures adaptées sont prévues pour accueillir les cyclistes, notamment des stations vélos.
Les chiffres révèlent déjà l’engouement pour cette initiative, puisque des milliers de kilomètres sont parcourus chaque année par les agents à vélo. Cela démontre l’intérêt croissant pour des pratiques respectueuses de l’environnement, tout en contribuant à l’amélioration de la santé des employés.
Impacts positifs sur la biodiversité et la vie professionnelle
Au-delà des enjeux climatiques, le CNRS ambitionne de mieux prendre en compte son impact sur la biodiversité. À travers divers projets et initiatives, l’établissement cherche à renforcer sa responsabilité envers l’environnement. L’intégration de considérations écologiques dans tous ses secteurs d’activité témoigne d’une véritable prise de conscience.
Сréation de synergies avec la société
Le CNRS ne se contente pas d’agir en interne. Il collabore avec d’autres instituts, universités et entreprises pour donner plus d’ampleur à ses actions. À travers des partenariats stratégiques, le CNRS cherche à développer des solutions innovantes pour faire face ensemble aux défis environnementaux. Une mission essentielle au cœur de cette dynamique est de partager les expériences et l’expertise pour faire avancer la cause du développement durable et de la recherche appliquée.
Amélioration du bien-être au travail
Les actions mises en œuvre par le CNRS en faveur de l’environnement ne se traduisent pas uniquement par des réductions d’émissions ou des économies d’énergie. Elles augmentent également le bien-être des agents. En favorisant le travail collaboratif, la formation et la sensibilisation, l’établissement œuvre pour une meilleure qualité de vie au travail. Cette approche se traduit par une plus grande motivation des employés, un engagement accru envers l’établissement et une culture d’entreprise responsable.
Vers une intégration totale des enjeux environnementaux
Le CNRS s’est engagé sur la voie d’une intégration complète des enjeux environnementaux dans toutes ses activités. Cela implique, bien sûr, de définir des objectifs clairs et mesurables, ainsi que des indicateurs pour suivre les progrès. Le travail effectué jusqu’à présent représente des jalons significatifs, mais l’établissement est conscient de la nécessité de continuer à évoluer et à innover.
Évaluation et ajustements
Les bilans carbone réguliers et les évaluations d’impact sont des outils déterminants pour ajuster les stratégies et initiatives. En ajustant ses actions en fonction des résultats, le CNRS fait preuve d’une agilité nécessaire pour s’adapter aux nouvelles réalités environnementales et scientifiques. La réflexion sur l’extension de ces évaluations à d’autres domaines montre une volonté de ne pas se limiter à des résultats superficiels, mais d’avoir un impact substantiel sur la durabilité.
Information et sensibilisation du grand public
Sensibiliser le grand public constitue également une part importante de la mission du CNRS. En partageant les résultats de sa transition avec la communauté scientifique et les citoyens, l’établissement cherche à promouvoir des comportements plus écologiques et à encourager la participation à des initiatives locales. La vulgarisation des connaissances scientifiques est essentielle pour mobiliser l’ensemble de la société dans les efforts vers un avenir durable.
Le CNRS : un modèle à suivre dans la transition environnementale
Les démarches entreprises par le CNRS peuvent être considérées comme exemplaires dans le panorama français et européen des établissements de recherche. En se fixant des objectifs ambitieux et en mettant en œuvre des actions concrètes, le CNRS incarne une volonté de leadership dans la colonisation des responsabilités environnementales.
Des perspectives d’avenir prometteuses
Avec des initiatives qui engagent l’ensemble de ses agents et une vision claire de l’avenir, le CNRS montre la voie à d’autres organisations souhaitant entreprendre leur propre transition vers un modèle bas carbone. Les premiers résultats encourageants et les engagements continus témoignent de l’efficacité des actions mises en place et de leur pertinence dans le contexte climatique actuel.
Avenir durable et responsabilité sociétale vont de pair. Le CNRS a donné le ton et s’affirme comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, faisant preuve d’ambition et d’innovation au service d’une planète résiliente, et inspirant d’autres à suivre la démarche.
Le développement durable est un processus complexe, souvent marqué par des résultats qui se manifestent à plus long terme. Cela a été souligné par Blandine De Geyer, référente nationale de démarche développement durable, qui explique qu’un plan de transition, tel que celui du CNRS, nécessite une période de sensibilisation et d’accompagnement. Et pourtant, après un peu plus d’un an, des dynamiques positives commencent à émerger, touchant plusieurs aspects de la recherche à travers les différentes délégations régionales.
Un des premiers leviers de cette transition est la sensibilisation et la formation des agents. Patrice Guyomar, référent développement durable de la délégation Occitanie Est, souligne l’importance de cette étape : « Nous avons mis en place un cycle de formation à la Fresque du climat, qui a permis à plusieurs agents de devenir des acteurs de cette transition ». Ce type d’initiatives constitue un fondement essentiel pour établir une culture institutionnelle axée sur l’environnement.
Du côté des achats écoresponsables, un tournant majeur a eu lieu. Une étude préalable a démontré que les achats représentaient 74 % de l’impact carbone du CNRS. Sébastien Turci, directeur de la DDAI, a affirmé : « Nous devons acheter moins, mais acheter mieux. » En intégrant des critères environnementaux dans les marchés, le CNRS prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte carbone dès le mois de juin 2023, en amont d’une obligation légale prévue pour tous les acheteurs publics.
Dans le cadre de la restauration collective, Virginie Mahdi a expliqué que cette période devient un terrain d’expérimentation pour le développement durable. En 2025, la délégation Occitanie Ouest introduira des critères environnementaux et sociaux dans son marché de restauration collective. Ce changement vise à diminuer l’impact de la restauration, qui représente une part significative des émissions de gaz à effet de serre du CNRS.
Les efforts ne se limitent pas aux achats et à la restauration. Le CNRS s’attache aussi à améliorer l’énergie de ses bâtiments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des travaux d’isolation ont permis de diminuer la consommation énergétique de certains laboratoires de manière significative. La réduction de 8 % de la consommation énergétique sur une année témoigne des avancées concrètes dans ce domaine.
En ce qui concerne les mobilités, l’organisation encourage l’usage du vélo et a mis en place une politique nationale pour promouvoir les mobilités douces. Le challenge « Mai à vélo » incarne cette volonté, en mobilisant les agents du CNRS vers des pratiques plus durables. L’objectif est de rendre le vélo accessible à tous ses agents, avec un aménagement de stationnements et une augmentation du taux de bénéficiaires du forfait mobilités durables.